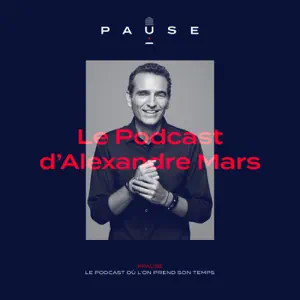On croit souvent que le débat sur la durée des vacances scolaires est récent. Pourtant, il agite la France depuis près de deux siècles. Déjà en 1835, un principal de collège se plaignait que l’on donne « trop de congés ».
Depuis, ministres, parents, enseignants et acteurs économiques s’affrontent sur un calendrier qui a façonné la vie de millions d’élèves… et bouleversé bien des familles.
Quand le XIXᵉ siècle fixait les vacances scolaires au rythme des champs et des fêtes religieuses
Au XIXᵉ siècle, les vacances suivent d’abord le rythme agricole et religieux. Après la loi Guizot de 1833, un règlement fixe à six semaines la durée maximale de l’été.
Cependant, les dates changent selon les départements : on part parfois mi-août, parfois début octobre. Les préfets, puis les recteurs, adaptent le calendrier pour coïncider avec les moissons ou les vendanges.
Dans le secondaire, la durée s’allonge : huit semaines en 1891, puis douze en 1912. Ainsi, les lycéens profitent d’un été plus long, calé sur les loisirs bourgeois… tandis que les enfants d’écoles primaires restent mobilisés pour les travaux agricoles.
À cette époque, il n’existe pas de “petites vacances”. On ferme seulement pour Noël, Pâques, la Toussaint ou le 14 juillet. Le reste de l’année, les cours se poursuivent.
De la création des petites vacances à l’alignement des calendriers entre écoles et lycées
Les années 1920 marquent un tournant. En 1922, les vacances d’été des primaires passent à deux mois, du 31 juillet au 30 septembre. Pâques offre désormais une semaine et demie de pause.
Peu à peu, les autorités locales cherchent à harmoniser les dates entre primaire et secondaire.
En 1933, le député André Cornu propose même d’avancer les congés au 1ᵉʳ juillet pour les lycéens, au 14 pour les écoliers. Son argument : éviter la chaleur de juillet, qui épuise les enfants.
Mais, il y a aussi des enjeux économiques : un calendrier mal placé peut nuire au commerce ou priver l’agriculture de main-d’œuvre.
En 1938, le ministre Jean Zay aligne enfin les vacances de tous les élèves : dix semaines d’été, du 14 juillet au 30 septembre. Il développe aussi les colonies de vacances et les garderies pour éviter de « laisser dans la rue les enfants pauvres ».
Du zonage des années 1970 aux réformes récentes qui continuent d’alimenter la controverse
Après 1950, le calendrier se rapproche de celui que nous connaissons. En 1959, l’été commence le 1ᵉʳ juillet et se termine le 15 septembre. On introduit cinq semaines de congés dans l’année, réparties entre Toussaint, Noël, février et Pâques.
À partir de 1972, le découpage en trois zones apparaît pour les sports d’hiver, évitant l’engorgement des stations.
Dans les années 1980, le calendrier « 7/2 » (sept semaines de cours, deux de vacances) est mis en place. La loi Jospin de 1989 fixe 36 semaines de cours et quatre périodes de vacances.
Depuis, les vacances d’été ont été réduites à huit semaines, celles de la Toussaint allongées à deux.
Pourtant, le débat revient sans cesse. En 1995, Jacques Chirac voulait réduire l’été pour alléger les journées. En 2013, Vincent Peillon proposait de passer de huit à six semaines.
Et en 2025, Emmanuel Macron relance la question, dans l’espoir – ou la promesse – de « penser d’abord aux élèves ».