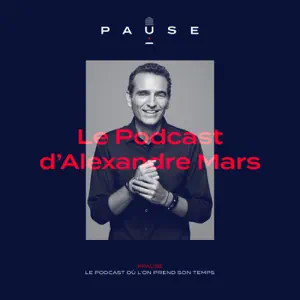Chaque année, c’est la même histoire. On se prépare psychologiquement au grand basculement, on sort les pulls du placard, on commande notre premier citrouille spice latte de la saison, et puis… surprise ! L’automne ne commence pas le 21 septembre comme notre cerveau semble l’avoir gravé dans le marbre, mais bien le 22. Alors, la Terre aurait-elle des problèmes de ponctualité ?
Le grand malentendu du 21 septembre
Si vous pensez que l’automne commence toujours le 21 septembre, rassurez-vous : vous n’êtes pas seul.e dans cette confusion temporelle. Cette date mythique s’est installée dans nos esprits comme une vérité absolue, au même titre que “il ne faut pas se baigner après manger” ou “les carottes rendent aimable”. Sauf que, comme souvent avec les idées reçues, la réalité est un peu plus complexe.
En fait, l’équinoxe d’automne – ce moment précis où le jour et la nuit durent exactement la même durée – peut tomber le 21, 22 ou même 23 septembre selon les années. En 2025, c’est le 22 qui a été désigné grand gagnant par les caprices de notre système solaire.
Une affaire de mécanique céleste
Pour comprendre pourquoi notre calendrier joue les trouble-fêtes, il faut remonter aux bases de l’astronomie. Notre bonne vieille Terre met exactement 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes pour faire le tour du Soleil. Problème : notre calendrier, lui, ne compte que 365 jours ronds. Ces quelques heures supplémentaires s’accumulent d’année en année comme les chaussettes dépareillées dans un tiroir.
C’est là qu’intervient notre sauveur : l’année bissextile. Tous les quatre ans, on ajoute un jour supplémentaire en février pour rattraper le retard. Malin, non ? Sauf que cette correction, aussi ingénieuse soit-elle, crée un décalage dans les dates des équinoxes et des solstices.
Imaginez que vous essayez de synchroniser votre réveil avec celui de votre voisin qui a trois minutes de retard. Même en rajustant régulièrement, il y aura toujours de petits décalages. C’est exactement ce qui se passe entre notre calendrier grégorien et la réalité astronomique.
Les caprices du calendrier grégorien
Le pape Grégoire XIII, qui a donné son nom à notre calendrier actuel en 1582 (calendrier Grégorien), avait bien cerné le problème. Il savait que son système ne serait pas parfait, mais c’était déjà un sacré progrès par rapport au calendrier julien qui partait complètement en vrille.
Le calendrier grégorien intègre une règle subtile : les années divisibles par 100 ne sont bissextiles que si elles sont aussi divisibles par 400. Ainsi, 1900 n’était pas bissextile, mais 2000 l’était. Cette astuce permet de corriger la sur-correction des années bissextiles classiques. Diablement intelligent, ce Grégoire !
Mais même avec ces ajustements, de légères variations subsistent. C’est pourquoi l’équinoxe d’automne danse entre le 21 et le 23 septembre, avec une préférence marquée pour le 22 dans notre époque.
Un phénomène qui varie selon les siècles
Si on prend un peu de recul historique, on s’aperçoit que les dates des équinoxes ne sont pas figées. Au début du calendrier grégorien, l’équinoxe d’automne tombait plutôt le 21 septembre. Progressivement, elle s’est décalée vers le 22, et d’ici quelques siècles, elle pourrait même flirter avec le 23.
Cette dérive lente s’explique par l’imperfection résiduelle de notre système de correction. Même avec toutes nos astuces calendaires, nous ne parvenons pas à coller parfaitement à la réalité astronomique. C’est comme essayer de découper un gâteau en parts exactement égales : théoriquement possible, pratiquement… compliqué.
L’automne, une question de point de vue
Au-delà de ces considérations techniques, il faut rappeler que l’automne astronomique ne correspond pas forcément à l’automne météorologique. Les météorologues, pragmatiques, ont décidé que l’automne météorologique commençait le 1er septembre. Pour eux, peu importe que la Terre soit légèrement de travers par rapport au Soleil : quand les températures chutent et que les feuilles commencent à rougir, c’est l’automne, point final.
Cette différence entre automne astronomique et météorologique illustre bien notre rapport ambivalent au temps. D’un côté, nous aimons la précision scientifique ; de l’autre, nous avons besoin de repères pratiques pour organiser nos vies. Et en 2025, la science nous dit que l’automne astronomique débutera précisément le 22 septembre.
Alors, 21 ou 22 ?
La prochaine fois qu’on vous demandera quand commence l’automne, vous pourrez briller en société en expliquant que “ça dépend”. Cette réponse de Normand cache en réalité une belle leçon d’humilité : même avec toute notre science et notre technologie, nous restons tributaires de mouvements célestes que nous ne maîtrisons pas complètement.
L’automne 2025 commence donc officiellement le 22 septembre à 14h19, heure de Paris. Mais que vous l’ayez fêté la veille ou le lendemain, l’essentiel reste le même : il est temps de ressortir les écharpes et de profiter du spectacle grandiose que nous offre la nature qui se pare de ses plus belles couleurs.