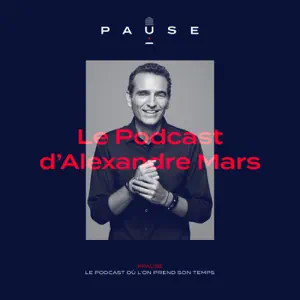À l’entrée d’une plage, au bord d’une piscine municipale ou sur une place animée, un distributeur blanc attire les regards. Pas de boissons fraîches ni de snacks salés, mais une pompe prête à délivrer gratuitement quelques noisettes de crème solaire. Depuis quelques années, cette idée, encore rare en France, séduit de plus en plus de collectivités et d’organisateurs d’événements. L’objectif est simple : protéger la peau du public et rappeler, de façon concrète, que le soleil, aussi agréable soit-il, reste un facteur de risque majeur pour la santé.
Une réponse concrète à un problème croissant
Selon Santé publique France, le nombre de cancers cutanés a plus que triplé au cours des 30 dernières années, et le mélanome figure désormais parmi les cancers les plus fréquents chez les moins de 50 ans. Une exposition excessive aux UV, surtout sans protection, en est la cause principale.
En mettant de la crème solaire à disposition, gratuitement et sans effort, les communes espèrent lever deux freins majeurs : l’oubli et le coût. Car si une bonne crème solaire est indispensable, elle représente aussi un budget conséquent pour les familles, notamment lors de séjours prolongés au soleil.
Un geste de prévention… et de pédagogie
Ces distributeurs ne sont pas qu’un service pratique : ils sont aussi un outil de sensibilisation. Les panneaux explicatifs rappellent les gestes essentiels : renouveler l’application toutes les deux heures, en mettre suffisamment et ne pas oublier les zones souvent négligées comme les oreilles, le cou ou le dessus des pieds.
L’approche a un autre avantage : elle dédramatise le geste de se protéger. Les enfants, en particulier, s’amusent parfois à “aller chercher leur dose” au distributeur, ce qui incite les familles à adopter une routine solaire plus régulière.
Des exemples en France et à l’étranger
En 2024, plusieurs villes de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont expérimenté ce dispositif sur leurs plages les plus fréquentées, à l’initiative d’associations de lutte contre le cancer et avec le soutien des mairies. Dans le Var, par exemple, les vacanciers ont pu bénéficier de bornes sur la plage centrale, financées par un partenariat public-privé.
Ailleurs dans le monde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, où le risque de cancer de la peau est particulièrement élevé, ont intégré ce type d’installations depuis des années. Certaines stations balnéaires disposent même de distributeurs automatiques intelligents qui calculent la quantité nécessaire selon l’indice UV du moment.
Des limites à prendre en compte
Si l’idée est plébiscitée, elle soulève quelques questions. D’abord, le respect des règles d’hygiène : les bornes doivent être régulièrement nettoyées et rechargées, ce qui implique un coût et une organisation. Ensuite, la qualité de la crème utilisée : pour être efficace, elle doit offrir une protection large spectre (UVA et UVB) et avoir un indice SPF d’au moins 30.
Enfin, les dermatologues rappellent que la crème solaire n’est qu’un élément de protection parmi d’autres : porter un chapeau, des lunettes de soleil et éviter l’exposition aux heures les plus chaudes reste essentiel.
Une mesure appelée à se développer
Les retours positifs des communes pilotes laissent penser que ces bornes pourraient devenir plus courantes dans les années à venir, notamment sur les plages touristiques et lors de grands événements sportifs ou culturels en plein air. Une manière simple de joindre l’acte à la parole : parler prévention, c’est bien, mais offrir un accès direct à la protection, c’est mieux.
Adopter ce type d’initiative, c’est reconnaître que la lutte contre les cancers de la peau passe aussi par des solutions visibles et accessibles à tous. Et si un geste aussi banal que se servir une noisette de crème pouvait sauver des vies, alors ces distributeurs n’ont pas volé leur place au soleil.
Ça va vous intéresser aussi :