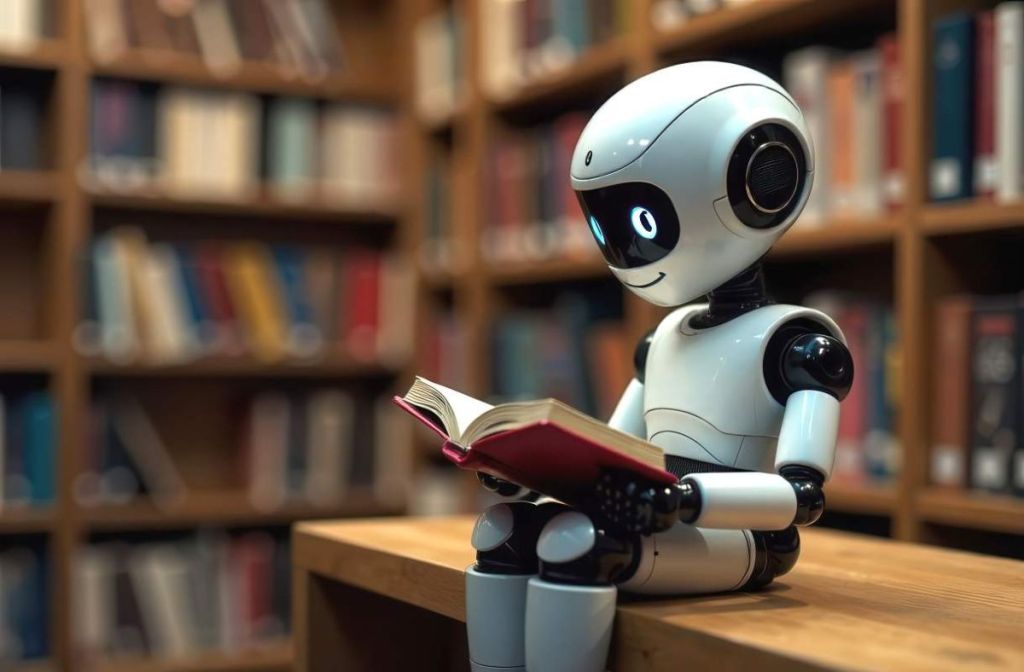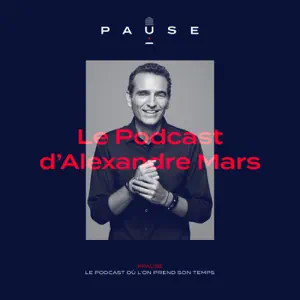Je corrige la philosophie du bac depuis quinze ans. Cette année, par jeu, des collègues m’ont confié une copie un peu spéciale : pas d’encre, pas de ratures, seulement quatre pages imprimées générées par ChatGPT. En marge, j’ai laissé les mêmes notes que pour mes élèves : « analyse trop descriptive », « absences d’exemples précis », « construction bancale ».
La machine s’en tire avec 9/20, exactement la note annoncée par l’expérimentation menée pour BFM TV ; le professeur sollicité par la chaîne estime que les références sont « trop allusives » et la profondeur d’argumentation insuffisante.
Ce score modeste tranche avec l’aura technologique qui entoure l’IA. Pourtant, il n’est pas isolé : mi-juin, France Inter a fait composer ChatGPT sur trois épreuves du bac. Verdict des correcteurs : 17-19/20 en mathématiques, mais seulement 7 ou 8/20 pour l’histoire-géographie et une dissertation d’environnement nord-américain. Autrement dit, l’algorithme brille dès qu’il faut dérouler un raisonnement calculatoire, mais il cale dès que l’exercice exige une pensée nuancée, portée par une culture scolaire implicite.
L’affaire rappelle que l’IA n’apprend pas vraiment? elle ne fait que recouper des probabilités.
Dans l’épreuve de philosophie, la copie humaine attendue suppose de problématiser, de s’appuyer sur des exemples choisis et d’articuler une démarche personnelle. ChatGPT, lui, rassemble des fragments de textes savants sans percevoir les attentes de l’épreuve.
Les correcteurs repèrent vite le style lisse et les transitions convenues. Un professeur interrogé par France Inter relève même la confusion entre conditions « nécessaires » et « suffisantes », signe que l’outil n’a pas saisi la logique profonde du raisonnement.
Cette faiblesse n’empêche pas la tentation. Selon Numerama, un lycéen d’Hyères a déjà été suspendu un an d’examen officiel pour fraude avec ChatGPT durant l’épreuve de français.
L’épisode illustre l’erreur fréquente : croire qu’on peut confier la feuille blanche à l’IA et passer à autre chose. La sanction tombe, et la note finale demeure médiocre.
Plutôt que de rêver à un “assistant copieur”, les élèves ont intérêt à détourner l’outil vers l’entraînement. Dans notre article consacré au corrigé du sujet « Notre avenir dépend-il de la technique ? », nous montrions comment transformer les attendus du bac philo en plan détaillé. L’idée : demander à ChatGPT de reformuler la question, de proposer plusieurs problématiques, puis de comparer ces pistes avec son propre brouillon. En procédant ainsi, on garde la main sur l’argumentation tout en profitant du moteur de suggestions.
Le même esprit critique vaut pour les disciplines littéraires… Solliciter l’IA pour établir une fiche de dates clés ou générer des questions possibles d’oral permet de réviser sans copier. Ensuite, on ferme l’écran et on structure soi-même une réponse, stylo en main ; l’appropriation passe par l’écriture manuelle et la verbalisation.
À plus long terme, cette discipline d’usage fera gagner du temps. Notre dossier « Être plus productif avec ChatGPT » rappelle qu’un prompt bien ciblé clarifie une notion en quelques secondes, là où un élève pouvait errer dans un manuel mal compris. Encore faut-il valider l’information : recouper avec le cours, chercher la source, questionner les exemples. La démarche rejoint l’esprit de l’IA : elle calcule, nous interprétons.
Reste la question pédagogique. Beaucoup d’enseignants, inquiets, envisagent de renforcer les épreuves orales et les travaux surveillés. D’autres préfèrent intégrer l’outil en classe pour apprendre à l’évaluer. Car la vraie compétence n’est plus seulement de réciter un cours, mais de dialoguer avec un agent conversationnel, d’en mesurer les limites et de produire une synthèse personnelle. Dans ce contexte, le 9/20 de ChatGPT est presque rassurant : la dissertation épargne encore sa part d’humanité.
En bout de copie, je griffonne toujours une phrase d’encouragement. À l’IA, j’aurais pu noter : « Des connaissances, mais pas de voix propre. » Aux lycéens, j’écris : « L’originalité se travaille ». Les robots s’améliorent ; la pensée critique reste notre meilleur atout.
Pour approfondir : nos dossiers « Faut-il avoir peur de l’IA ? » et « Le bac est-il plus facile qu’avant ? » complètent la réflexion et offrent des pistes pour réviser sereinement avec — et non contre — les outils numériques.