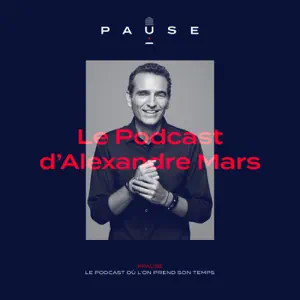La session 2025 du diplôme national du brevet marque un tournant : une quatrième distinction, baptisée « très bien avec félicitations du jury », vient coiffer le palmarès. L’objectif ? Saluer l’excellence de collégiens qui terminent leur cycle avec une moyenne d’au moins 18/20, symbole d’engagement et de régularité.
Une mention taillée pour les meilleurs profils
Un arrêté publié au Journal officiel le 27 février 2025 fixe la barre : 720 points sur 800 pour les candidats scolaires ou 360 sur 400 pour les candidats individuels. Concrètement, il faut compiler au moins 18 points sur 20 grâce au contrôle continu (400 points) et aux épreuves finales (400 points) pour prétendre aux félicitations.
Pourquoi cette évolution ?
Le ministère de l’Éducation nationale souhaite harmoniser le brevet avec le baccalauréat, déjà doté d’une mention similaire, et encourager l’ambition dès la classe de troisième. Les statistiques confirment cette dynamique : le taux de réussite dépasse 85 %, et la proportion de mentions ne cesse de grimper. L’ajout d’un palier supplémentaire valorise les élèves qui franchissaient déjà le seuil du « très bien ».
Comment s’organisent les épreuves ?
Les écrits se sont déroulés les 26 et 27 juin 2025, puis les 8 et 9 septembre pour la session de remplacement. Ils comptent autant que le contrôle continu : chaque discipline est évaluée sur 50 points et le socle commun pèse 400 points au total. Maîtriser ce barème permet d’anticiper où grappiller les points manquants.
Les retombées concrètes des félicitations
Au-delà de la satisfaction personnelle, cette mention ouvre la porte à la bourse au mérite, attribuée aux élèves boursiers qui obtiennent au moins 16/20. Les félicitations, en plaçant la moyenne au-delà de 18, sécurisent l’éligibilité et donnent du poids aux dossiers de seconde, notamment pour les sections européennes ou bilingues.
Un nouvel équilibre dès 2026
La réforme présentée en avril 2025 acte une redistribution des coefficients : à compter de la session 2026, les épreuves finales pèseront 60 % de la note globale, le contrôle continu retombant à 40 %. Le socle commun comptera donc 320 points sur 800, contre 480 points pour l’examen terminal.
Les collégiens devront maintenir des notes stables toute l’année, mais ils ne pourront plus compenser une préparation insuffisante aux écrits ; qui (re)deviennent la véritable clé du diplôme. Mieux vaut donc adopter dès maintenant des méthodes de révision qui accordent une place importante aux annales et aux entraînements chronométrés.
La clé : monter un plan de révision efficace
Un bon équilibre entre révisions régulières et entraînements chronométrés, des fiches synthétiques dès le deuxième trimestre, assurent une base solide ; des examens blancs à partir d’avril affinent la gestion du temps.
Adopter une routine de respiration consciente – expliquée pas à pas dans cet article AirZen – aide à stabiliser le rythme cardiaque et à améliorer la concentration. Pratiquer trois minutes avant chaque séance de travail oxygène le cerveau et limite la fatigue mentale.
En route vers la réussite
La nouvelle distinction élève le niveau d’exigence, mais elle reste accessible à celles et ceux qui anticipent, structurent leurs révisions et prennent soin de leur bien-être. Une stratégie méthodique, soutenue par une hygiène de vie équilibrée, demeure le meilleur passeport vers les « félicitations du jury ».
Ça va vous intéresser aussi :
- Bien-être : comment mieux respirer peut aider à la réussite de ses examens
- Florian Manicardi renforce la mémoire des étudiants et séniors
- Comment stimuler sa mémoire en période d’examens ?